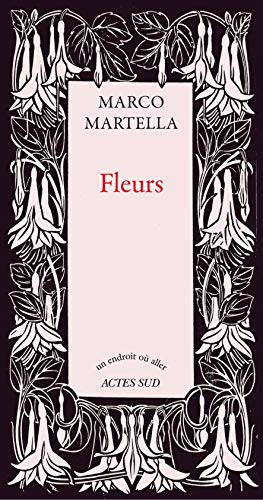J’AI retrouvé au fond d’un tiroir un vieux dictaphone que j’utilisais pour enregistrer les premiers entretiens réalisés pour ma revue, il y a quelques années. À l’intérieur, il y avait encore une cassette, sur laquelle était écrit : Dorothy Paz, 12 novembre 2010, café Rostand. Elle contenait l’enregistrement de l’entretien que la professeure Paz m’avait accordé lorsqu’elle était de passage à Paris. À l’époque, l’interview m’avait paru inexploitable pour un article et j’avais fini par l’oublier, mais je me rendis compte, en revoyant la cassette, que le souvenir de cette rencontre était resté dans un coin de mon esprit pendant toutes ces années. Il me suffit d’allumer le dictaphone et d’entendre à nouveau le son de la voix de Mrs Paz, son français à l’accent américain à peine perceptible, pour que je la revoie comme si cet entretien avait eu lieu la veille et non dix ans plus tôt. Elle me fixait de son regard sérieux, voilé de tristesse, et il me semblait qu’elle attendait encore quelque chose de moi, une réponse, peut-être, à une question qui n’avait finalement pas été formulée clairement lors de notre rencontre au Rostand. Quelques semaines avant l’entretien, la traduction française de son dernier essai, Le Poète dans la forêt, que certains considèrent aujourd’hui comme son testament, avait été publiée en France. Plus qu’un essai, disait la quatrième de couverture, c’était une méditation sur la présence de la nature sauvage dans l’œuvre d’écrivains tels que Chateaubriand, Zola ou Colette, jusqu’aux nature writers américains du XXe siècle. Un sujet inattendu pour la professeure Paz, spécialisée dans la narratologie structurale et qui n’avait jamais montré, dans ses recherches, un intérêt quelconque pour ce thème, que d’ailleurs son livre traitait d’une manière parfois hésitante, sinon maladroite, ce qui était inhabituel pour une essayiste toujours si sûre d’elle. Je la revois assise devant moi dans la salle presque vide du café, en face du jardin du Luxembourg. Derrière le comptoir, deux ou trois serveurs bavardaient à voix basse dans la pénombre. Dehors, il tombait des cordes mais, malgré la grisaille automnale, la masse jaune vif des marronniers du jardin brillait, éclatante. Je n’avais rencontré Mrs Paz que deux ou trois fois auparavant, lors de soirées de signature dans des librairies parisiennes ; assis devant elle, je réalisai qu’elle était beaucoup plus jeune que dans mon souvenir, trente-cinq ans tout au plus. Elle souriait rarement et avait l’air un peu intimidant de quelqu’un qui a consacré son existence à une seule tâche, dans son cas la critique structuraliste. “Une moniale de la déconstruction littéraire”, c’est ainsi que son éditeur parisien l’avait présentée, non sans humour, dans un article.
Elle me fixait de son regard sérieux, voilé de tristesse, et il me semblait qu’elle attendait encore quelque chose de moi, une réponse, peut-être, à une question qui n’avait finalement pas été formulée clairement lors de notre rencontre au Rostand.
Quelques semaines avant l’entretien, la traduction française de son dernier essai, Le Poète dans la forêt, que certains considèrent aujourd’hui comme son testament, avait été publiée en France. Plus qu’un essai, disait la quatrième de couverture, c’était une méditation sur la présence de la nature sauvage dans l’œuvre d’écrivains tels que Chateaubriand, Zola ou Colette, jusqu’aux nature writers américains du XXe siècle. Un sujet inattendu pour la professeure Paz, spécialisée dans la narratologie structurale et qui n’avait jamais montré, dans ses recherches, un intérêt quelconque pour ce thème, que d’ailleurs son livre traitait d’une manière parfois hésitante, sinon maladroite, ce qui était inhabituel pour une essayiste toujours si sûre d’elle. Je la revois assise devant moi dans la salle presque vide du café, en face du jardin du Luxembourg. Derrière le comptoir, deux ou trois serveurs bavardaient à voix basse dans la pénombre. Dehors, il tombait des cordes mais, malgré la grisaille automnale, la masse jaune vif des marronniers du jardin brillait, éclatante. Je n’avais rencontré Mrs Paz que deux ou trois fois auparavant, lors de soirées de signature dans des librairies parisiennes ; assis devant elle, je réalisai qu’elle était beaucoup plus jeune que dans mon souvenir, trente-cinq ans tout au plus. Elle souriait rarement et avait l’air un peu intimidant de quelqu’un qui a consacré son existence à une seule tâche, dans son cas la critique structuraliste. “Une moniale de la déconstruction littéraire”, c’est ainsi que son éditeur parisien l’avait présentée, non sans humour, dans un article. Alors que nous buvions notre café avant de commencer l’entretien, elle m’expliqua que depuis qu’elle était à Paris elle n’avait fait que répondre à des journalistes pour la promotion de son dernier essai et qu’elle commençait à trouver cela lassant. Elle avait accepté cet entretien pour une revue comme la mienne en espérant que nous parlerions d’arbres plutôt que de livres.
Je commençai l’entretien en lui demandant quel était son premier souvenir d’une forêt. Dans son enfance, dit-elle, ses parents ne l’avaient jamais emmenée se promener dans les bois, comme c’est l’usage dans la plupart des familles américaines moyennes. Ils habitaient Boston et ne quittaient la ville que pour voyager au Mexique, dont son père était originaire, et surtout en Europe. La première fois qu’elle avait vraiment regardé une forêt, c’était lors d’une sortie scolaire, alors qu’elle devait avoir quinze ou seize ans.
Son professeur de lettres emmenait souvent ses étudiants visiter des hauts lieux de la littérature en Nouvelle-Angleterre. Cette année-là, il avait choisi de les emmener à Lenox afin de leur faire découvrir The Mount, la demeure que la romancière Edith Wharton et son mari s’étaient fait construire en 1902 dans ce coin isolé de la région. “Je me souviens encore de l’émotion que j’éprouvai à l’entrée du domaine, dit Dorothy, en voyant les écuries blanchies à la chaux et les grands arbres surgissant au milieu d’une pelouse brise et le jardin ordonné derrière moi ! Dans les deux cas, il y avait une profusion de couleurs, mais un monde séparait les fleurs du jardin des fleurs de la prairie, le rouge délicat des roses du rouge sang des coquelicots. Puis, au fond de cette clairière la forêt apparut. Un rideau très dense d’arbres sans forme précise qui tranchait avec la beauté formelle du jardin, qui semblait nier son droit à exister. Je frissonnai car je crus soudain sentir le souffle de la forêt qui, ayant traversé la prairie, touchait mon visage, mais quand je me retournai je revis les roses, les parterres de buis taillés, les fontaines – oui, j’étais dans une villa florentine ! Et ce jardin qui depuis qu’Edith l’avait dessiné était resté tel quel, qui avait défié non seulement la nature sauvage mais aussi le temps, me parut encore plus précieux. Un petit monde artificiel, fragile et pathétique, certes, mais vivant et accueillant, comme un beau livre.”
Après cette visite au Mount, Dorothy n’avait plus songé à la forêt. Bien entendu, celle-ci réapparaissait sans cesse au cours de ses lectures puis de ses recherches, mais elle n’était, à ses yeux, qu’un topos littéraire, et la jeune étudiante qu’elle était, éprise de culture française, regardait avec un certain mépris l’attraction romantique pour la nature sauvage qu’éprouvent la plupart des intellectuels américains, orphelins, comme elle le disait, de Thoreau et de Whitman. Seule la langue comptait. Qu’elles soient animées ou non, les choses du monde n’avaient ni sens en elles-mêmes, ni valeur, tant que la parole ne s’emparait pas d’elles pour leur donner une forme, les rendre intelligibles. D’ailleurs, qu’est-ce que c’était que l’art sinon une tentative d’échapper à la brutalité de la nature, à l’œuvre de destruction du temps ? “Et puis il y eut la Hoh Rainforest, dit Dorothy. Comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu.” Je repensai à l’évocation, dans l’épilogue de l’essai de Mrs Paz, de cette forêt pluviale située dans l’État de Washington, au nord-ouest des États-Unis, une des dernières forêts primaires au monde. Je lui dis à quel point j’avais été saisi par ces quelques pages, pour moi les meilleures du livre, où son écriture prenait un accent personnel, un peu déroutant pour qui connaissait ses précédents ouvrages, et où il n’était plus question de littérature, seulement du sous-bois.
“C’était il y a un an, alors que je me trouvais à Seattle pour un colloque. J’avais accepté l’invitation de trois collègues du département de littérature comparée à les suivre dans une excursion à Hoh dans l’Olympic National Park, par pure politesse à vrai dire. Je craignais de me retrouver dans un de ces horribles parcs nationaux américains toujours envahis de familles bruyantes, de camping-cars et de randonneurs. Je me souvenais de Yosemite, en Californie, et de ses séquoias millénaires encerclés de visiteurs assis en adoration silencieuse, les yeux fermés, comme s’ils étaient, que sais-je, des chamans indiens ! Mais la forêt de Hoh, c’était autre chose… Il pleuvait ce jour-là, la saison touristique n’était pas encore commencée et mis à part mes collègues et moi il n’y avait personne. La forêt me saisit dès les premiers pas, presque physiquement. Dans la pénombre tantôt grise tantôt verdâtre, nous étions entourés d’un chaos de troncs couchés, recouverts de strates épaisses de mousse, sur lesquels d’autres arbres avaient pris racine. Tandis que nous avancions en file indienne sur le sentier, mes yeux s’égaraient dans cet enchevêtrement de branches et de lichens qui pendaient jusqu’au sol comme des rideaux en lambeaux. L’un de mes collègues nous expliqua que c’était l’abondance des précipitations qui permettait une telle luxuriance, ce concentré de vie qui avait atteint son climax il y a des millénaires et qui depuis poursuivait son existence, immuable. Il nous parla des conifères et des feuillus qui avaient colonisé le Nord-Ouest du continent bien avant l’apparition de l’homme sur terre et dont il ne restait plus que cette forêt s’étendant sur trente-huit kilomètres le long du fleuve Hoh. Au bout de quelques minutes, je n’écoutais plus. Des sentiments que je ne connaissais pas, qui ne m’appartenaient pas vraiment, se bousculaient dans mon cœur. L’envie me prit de quitter le sentier de randonnée, de marcher au milieu du chaos. Je laissai les autres me distancer et je m’aventurai dans la forêt. En enjambant les troncs couchés, en écartant les lianes, je me frayai un passage. Il était très pénible, parfois presque impossible, d’avancer, les muscles de mes jambes me faisaient mal, je trébuchai plusieurs fois car mon poncho imperméable me gênait. Et maintenant que j’étais seule et que les voix de mes amis s’étaient éteintes au loin, je m’aperçus que la forêt baignait dans un silence à peu près total. Je m’arrêtai un instant : pas de chant d’oiseaux, ni de bourdonnement d’insectes. Seules les quelques gouttes de pluie qui parvenaient à pénétrer la canopée, très haute au-dessus de ma tête, résonnaient de temps en temps en tombant sur les troncs couchés.” Dorothy avançait maintenant avec difficulté dans son récit. Elle était visiblement en train de se frayer un chemin dans ses souvenirs comme à travers le désordre de branches et de lianes de la forêt. Elle était là devant moi et en même temps à l’autre bout du monde, loin de cette grise journée parisienne et du Rostand. “Où étais-je en train de me diriger ? J’avais perdu mes repères car dans une forêt comme celle-là, toutes les directions semblent se valoir. Mes chaussures trempées s’enfonçaient dans un sol étonnamment souple. Mon collègue nous avait expliqué qu’il s’était formé au fil des millénaires grâce à la décomposition des feuilles, du bois et des animaux morts, à l’humidité, au travail incessant des insectes et des vers, si bien que j’avais l’impression de marcher sur des couches épaisses et humides de temps, accumulées là depuis les origines de la terre. Les gouttes de pluie aussi semblaient tomber d’un monde distant, d’un monde d’avant le monde où les hommes n’avaient pas de place. Dans cette forêt, je n’étais qu’une intruse. Alors j’eus peur, car je réalisai que je m’étais égarée. Dans la pénombre, derrière des parois de feuillages et de lianes, je crus percevoir une lueur. Je me dirigeai vers elle et au bout de quelques mètres je débouchai sur une petite prairie. Peut-être avait-on coupé des arbres à cet endroit ou retiré le bois mort, toujours est-il que cette clairière avait une forme parfaitement ronde. Dans la lumière éclatante, après la pénombre du sous-bois, il me sembla distinguer des fleurs, floues mais d’un blanc très pur, qui, bien qu’immobiles, ressemblaient – je les vois encore clairement – à une myriade de petites flammes. Elles étaient sans doute, me dis-je aujourd’hui, de simples narcisses, mais elles me parurent extraordinaires, les fleurs d’un autre monde. De peur de les piétiner, je n’osais pénétrer dans la clairière. Une voix, au plus profond de moi, me disait que j’avais juste le droit de rester là où j’étais, au bord de cette petite prairie, comme si celle-ci était un enclos sacré, de la regarder de l’extérieur. En proie à des pensées aussi irrationnelles que confuses, je m’assis sur un tronc mort et je restai à caresser l’écorce humide, sentant le mouvement incessant des insectes dans la mousse. C’était donc cela, la vie…
Marco Martella, Fleurs, un endroit où aller Actes Sud